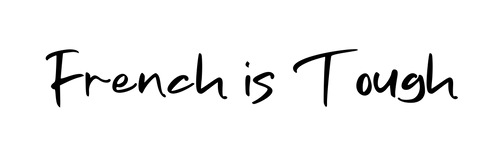Avoir la gueule de bois : une expression française qui fait mal à la tête

En France, il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire qu'il "a la gueule de bois" au lendemain d'une soirée bien arrosée. Cette expression imagée, qui fait référence à une gueule (à savoir le visage ou la bouche) lourde et douloureuse comme si elle était en bois, décrit l'état d'une personne souffrant d'une bonne gueule de lendemain : ce qu'on appelle en anglais un "hangover". Mais d'où vient cette expression colorée ? Et pourquoi parle-t-on de bois pour qualifier cet état ?
Mais d'où vient l'expression ?
L'origine de "la gueule de bois" remonte au XIXᵉ siècle, période où l'expression a commencé à se diffuser dans le langage courant. En vieux français, le terme "gueule" était employé pour désigner la bouche des animaux, avant d'être progressivement utilisé de manière familière pour parler de la bouche humaine ou, par extension, du visage entier. Quant au bois, il fait référence à une sensation de rigidité, de lourdeur et d'engourdissement, comme si les membres étaient littéralement figés par un matériau dur.
Une autre hypothèse historique se rattache à l'effet du vin ou de l'alcool sur le corps : autrefois, on associait les gueules de bois à une "surcharge" du système, une sorte d'empoisonnement temporaire provoquant des douleurs et une sensation de lourdeur extrême. L'idée du bois traduit bien cette immobilité et cette incapacité à fonctionner normalement.
Lire aussi : Les origines de l'expression « coup de cœur »
Signification et usage contemporain
Aujourd'hui, avoir la gueule de bois ne se résume pas seulement à une migraine. L'expression évoque à la fois la fatigue, la soif intarissable, les nausées et cette sensation générale de malaise qui suit souvent une soirée trop arrosée. Utilisée dans un registre familier, elle peut aussi inclure une pointe d'humour ou d'autodérision.
Par exemple :
"Oh là là, j'ai trop abusé hier soir, j'ai une gueule de bois carabinée !" Dans cet exemple, l’expression traduit une sorte d'aveu, souvent accompagné d'un sourire contrit.
Mais elle peut aussi servir dans des contextes plus abstraits pour décrire un état d’âme après un "excès" non alcoolisé, comme une surdose d'activité ou d'émotions :
"Après trois jours de conférence, j'ai une gueule de bois mentale."
Anecdotes et situations réelles
Imaginez un groupe d'amis qui se réveille après une soirée à refaire le monde autour de bouteilles de vin rouge. L'un d'entre eux, encore enroulé dans une couverture, marmonne : "Je crois que je vais éviter le vin pendant un moment... j'ai la gueule de bois." Les autres rient, bien conscients qu'il n'en sera rien lors de la prochaine fête.
Un autre scénario courant ? Ce collègue qui, le lundi matin, arrive au bureau avec des lunettes de soleil et commande un café triple expresso. Lorsqu'on lui demande comment était son week-end, il hoche la tête avec un petit sourire fatigué et dit simplement : "Gueule de bois..."
Il faut dire que cette expression s’accompagne souvent d’un soupçon de fierté (comme pour dire : "Oui, j'ai profité de la vie !") et d'une bonne dose d'autodérision. Cette combinaison en fait une expression emblématique de la culture française où plaisir et excès vont souvent de pair.